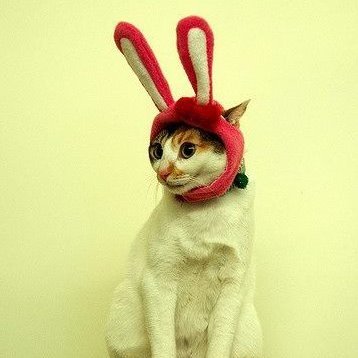
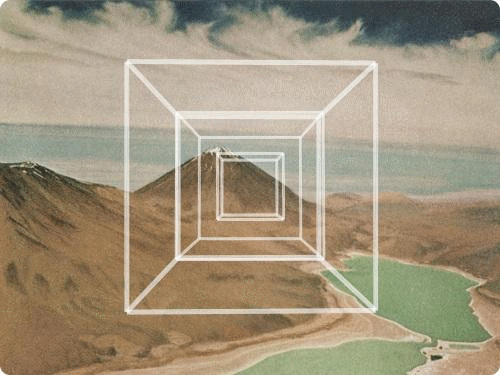
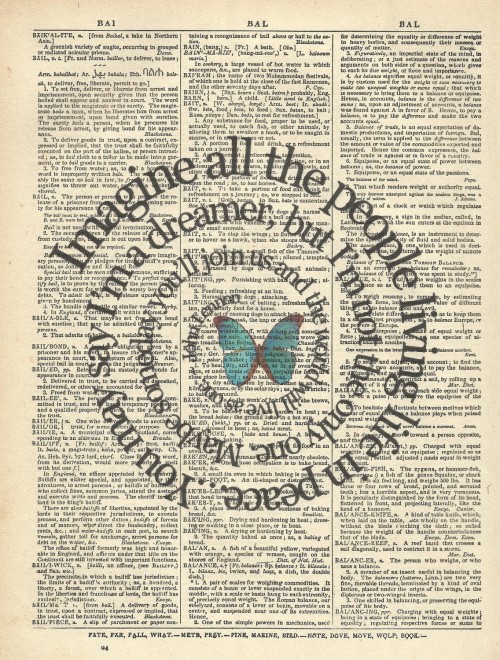
Humanités numériques et fonds patrimoniaux – Exploitation d’archives et réflexions sur le processus de patrimonialisation aux Archives Henri-Poincaré (UMR7117)2
2022-09-01
La formalisation, inévitable au recours à l’informatique, est parfois crainte, en ce qu’elle réduit les phénomènes en jeu dans les humanités. Nous proposons ici de la considérer également comme vecteur de précision. A partir d’exemples concrets, et par son exposition en contexte, il s’agira de montrer que différentes formes de formalisation engendrent différents types de précision, et d’en discuter les formes, dans différents travaux en humanités numériques. A partir de cette ébauche de typologie, nous chercherons à mettre en lumière et discuter les bénéfices et limites de ces formalisations, de ces précisions, de natures différentes.
Le projet ANR PatriMaths vise à étudier, du point de vue historique, les processus de patrimonialisation dont les mathématiques ont fait l’objet, du XVIIIe au XXe siècle, que ce soit au moyen de supports imprimés (encyclopédies, dictionnaires spécialisés ou généralistes, œuvres complètes de mathématiciens, collections de traités et de manuels) ou d’outils destinés à rassembler et répertorier une partie des savoirs déjà produits (bibliothèques, répertoires bibliographiques). L’objectif est double : d’une part, comprendre ce qui fait patrimoine en mathématiques à une époque et pour une communauté donnée, mais aussi comment – et par qui – il est fait patrimoine, par sélection, appropriation, adaptation, codification ou normalisation des savoirs et des pratiques ; d’autre part, analyser les usages de ces patrimoines : la façon dont ils sont utilisés pour faire des mathématiques, dans l’espace savant comme dans l’espace social, mais aussi la façon dont ils participent à la construction de l’identité d’un groupe ou à la légitimation et à la visibilité de la discipline. Il s’agira, au cours du séminaire, de présenter rapidement le projet dans son ensemble et surtout les aspects numériques (modélisation des connaissances, plateforme et outils pour l’exploitation).
Pour qui ouvre-t-ton les savoirs ?
Dans les politiques institutionnelles de sciences ouvertes, la question
de l’appropriation des savoirs et des données ouvertes au-delà des
acteurs de la recherche eux-mêmes, rencontre celle des relations entre
science et société. Elle rejoint notamment les enjeux de la médiation
scientifique et des sciences participatives et vient questionner nos
modèles de communication. A quelles conditions peut-on parler
d’appropriation des savoirs et des données ouvertes ? Observe-t-on
aujourd’hui des situations effectives d’appropriation – au-delà de
l’accessibilité ? Comment cela s’articule-t-il avec nos méthodes de
recherche et nos épistémologies ?
A partir d’exemples, je questionnerai le lien entre science ouverte et valorisation sociale des savoirs.
Négligés par l’histoire des techniques, les objets de la vie domestique et du quotidien, sont ici étudiés, par le prisme des Arts ménagers culinaires. L’omniprésence des objets techniques à la maison et particulièrement en cuisine est inversement proportionnelle à l’intérêt accordé à ces objets en histoire des techniques. Témoins et acteurs, les objets culinaires sont en interrelations avec hommes et femmes. Appropriation scientifique, patrimoniale, muséale, individuelle, sociétale ou encore familiale sont ainsi mises en avant. Ces échanges, confrontations et co-constructions sont à interroger et différents niveaux d’appropriation à décliner, afin de faire ressortir les valeurs heuristiques de ces objets (particulièrement l’autocuiseur, le réfrigérateur et le micro-ondes). Dans un XXe siècle élargi (1880-1980) en insistant sur l’entre-deux-guerres (objets assimilés à de la science) et les Trente Glorieuses (objets de consommation), l’analyse des cristallisations culturelles, politiques, sociales, techniques et géopolitiques inscrites dans ces objets familiers est abordée dans nos recherches dans une approche comparative afin de cerner la spécificité d’un mode d’appropriation français des Arts ménagers culinaires.
Travailler sur un sujet de recherche à la croisée de plusieurs champs disciplinaires et domaines, peu exploités et surtout d’une grande diversité de formes a nécessairement imposé un questionnement sur le corpus de sources mobilisables et mobilisées. Le chercheur se retrouve alors dans une situation inédite, à laquelle il n’a été ni formé ni préparé, de « créateur de sources ». En passant « du côté » de l’archive, qu’elle soit papier, figurée ou objet, l’historien débute alors un travail nouveau et enrichissant pour sa recherche et un autre rapport avec les archivistes. Après un rapide état des lieu des sources disponibles et des méthodologies de recherche déployées dans nos travaux et études sur les Arts ménagers, nous aborderons les expériences de développement et usages d’archives numérisées. Trois situations seront particulièrement mises en avant: le « travail » des sources opéré lors de la thèse, les recherches plus récentes sur l’archivage du geste culinaire et la collaboration entre les Archives municipales de Saint-Etienne dans le cadre de la numérisation des fonds d’archives de l’entreprise Casino.
Une ontologie informatique est une conceptualisation explicite et partagée d’un domaine, qui est réalisée au travers d’un modèle dans une formalisme de représentation des connaissances. Construire une ontologie en lien avec une application en humanités numériques peut avoir plusieurs objectifs : fournir un cadre de description des métadonnées d’un corpus, un modèle pour l’intégration d’informations en provenance de plusieurs sources, une base pour le raisonnement en intelligence artificielle, etc. Dans cette présentation, je discute au travers de plusieurs exemples (en littérature, en musique, iconographie) comment le processus de construction d’une ontologie permet aussi, indépendamment de son utilisation, de faire avancer la compréhension des notions et concepts d’un domaine, en particulier quand celui-ci est peu formalisé. Je m’attarderai en particulier à montrer comment cet exercice, qui s’apparente à du pinaillage, oblige à séparer certains concepts en plusieurs niveaux d’abstraction nécessaires à une description précise de ces concepts et des entités qui s’y rattachent.